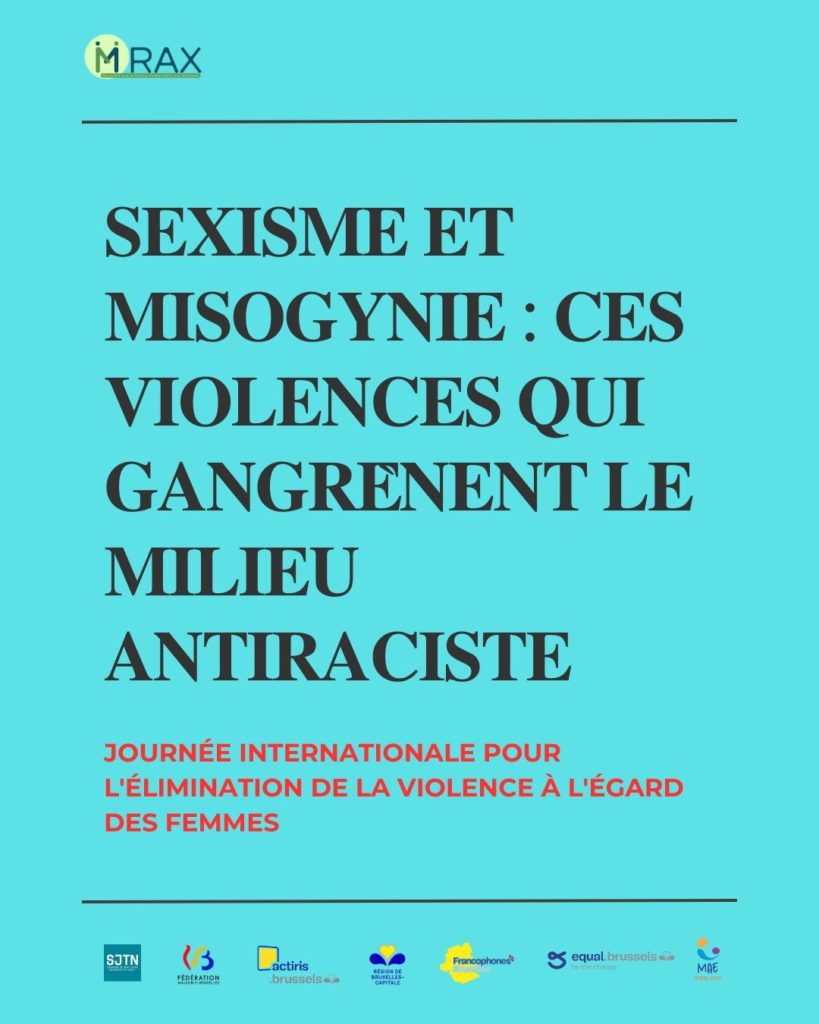Le conflit belgo-belge relève-t-il du racisme ? Peut-être. La langue en est-elle l’élément fondamental ? Non. La preuve par Bruxelles, laboratoire multiculturel… Rencontre avec Eric Corijn, Bruxellois néerlandophone, philosophe et sociologue de la culture à la VUB.
Anne Morelli estime que le racisme belgo-belge existe et qu’on a tort d’exclure le facteur linguistique des lois qui répriment le racisme… Quel est votre sentiment à cet égard ?
haque être humain a des problèmes avec « l’autre ». Ce qui devient du racisme, c’est de fonder sur ces problèmes une idéologie de société, et même des partis ou des institutions. Donc Anne Morelli a raison : le vrai problème en Belgique est la façon dont on accompagne idéologiquement la xénophobie. Dans les autres états fédéraux, comme l’Allemagne, il existe des liens culturels et interculturels entre les états fédérés. En Belgique, de plus en plus, au niveau des médias et de la façon générale de voir, on parle de l’autre comme étant l’étranger.
![]() Que pensez-vous de la récente affiche électorale (« Minder Frans, meer Brigitte ») de Brigitte Grouwels ?
Que pensez-vous de la récente affiche électorale (« Minder Frans, meer Brigitte ») de Brigitte Grouwels ?
C’est scandaleux mais est-ce du racisme ? Je dirais plutôt du chauvinisme. Un des politiciens les plus populaires en Wallonie a fait sa carrière au départ du problème des Fourons… Le FDF est un parti créé autour de la langue, est-ce que c’est un parti raciste ? Est-ce qu’on doit l’interdire ? La voie légale n’est pas la meilleure car elle renforce la lutte pour l’hégémonie. Le problème est que l’autonomie culturelle est basée sur la langue. On croit que la langue est l’élément fédérateur de la culture.
Ce n’est pas le cas ?
Non. À Bruxelles par exemple, le français est la langue parlée par la majorité des gens mais je ne pense pas que le français soit « la » culture à Bruxelles. Il y a « des » cultures à Bruxelles.
Vous vivez à Bruxelles. Vous estimez que votre langue y est suffisamment respectée ?
C’est une langue minoritaire et c’est vrai que les droits des minorités linguistiques ne sont pas vraiment respectés par les institutions. On parle toujours du bilinguisme des fonctionnaires mais, rien que d’obtenir un formulaire en néerlandais c’est difficile. Il ne faut pourtant pas parler le néerlandais pour donner un papier !
Vous avez l’impression que votre langue est dénigrée par les francophones ?
Ne généralisons pas. Il n’y a jamais eu autant de politiciens francophones qui ont appris le néerlandais. C’est souvent symbolique mais ils font l’effort, alors qu’avant c’était « Et la même chose pour les Flamands ». Ce qui est clair, à Bruxelles, c’est qu’il y a eu un effet de balancier. Bruxelles s’est francisée quand la bourgeoisie et la direction de l’Etat parlaient le français. Donc tous les Flamands qui venaient s’installer à Bruxelles envoyaient leurs enfants à l’école francophone. Avec les lois linguistiques, où le bilinguisme est devenu un atout, tous ces flamands ont eu un avantage sur le marché du travail et, tout d’un coup, leur pouvoir d’achat a monté. Le phénomène s’est alors accompagné d’une émergence cultuelle, avec toute une série d’avant-gardes, avec la gentryfication de la rue Dansart, la mode flamande, le cinéma flamand, la danse, Arno…Tout d’un coup la culture flamande devenait intéressante. Donc le rapport à la langue a souvent à voir avec la position sociale. Il est clair maintenant qu’à Bruxelles, beaucoup de ce qui se fait au niveau culturel est subventionné par la Communauté flamande, mais avec beaucoup d’interculturel et de mixité, ce qui n’existe pas, ou beaucoup moins, du côté francophone.
Vous avez signé le Manifeste bruxellois, qui réclame une communauté bilingue à Bruxelles. N’est-ce pas une manière pour les Flamands de mettre la main sur Bruxelles ?
L’enjeu est que les compétences actuellement communautaires passent à la Région bruxelloise. Ce n’est donc justement pas lié à la langue puisqu’il s’agit de délier les matières personnalisables de leur appartenance linguistique : éducation, culture, soins de santé… Actuellement, Bruxelles est une des seules villes au monde qui n’a pas de politique culturelle ! Deux communautés opèrent sur le terrain mais il n’y a pas d’écoles, de théâtres, d’institutions communes… Je suis pour que la langue maternelle, au début de la vie, soit aussi celle employée à l’école, car ce n’est pas bon d’avoir une rupture trop grande. Mais l’école doit aussi pouvoir fonctionner comme transition. On ne doit pas nécessairement être éduqué dans une seule langue. Si on parle d’écoles bilingues ou multilingues, il ne s’agit pas d’avoir plus de cours de langue. Il s’agit de donner, par exemple, l’histoire en français et la géographie en néerlandais. Pour l’instant, on apprend les matières dans sa langue et on apprend les langues dans un cours de langue. Mais on peut mélanger et apprendre des choses dans une autre langue. Il existe des expériences d’immersion qui fonctionnent bien.
Mais cette communauté que vous évoquez, elle se ferait tout de même un peu contre l’idée d’une communauté Wallonie Bruxelles…
Est-ce que les Bruxellois francophones se sentent tellement proches de la Wallonie ? Ce n’est pas une communauté, justement. Toute forme de communauté est construite. Est-ce que l’Europe existe ? Oui, ça commence… mais ça n’existe que dans la mesure où les institutions européennes développent une production culturelle et qu’elles soutiennent, par exemple, le film européen. C’est par ce biais que le film européen commence à exister. La famille, ça existe mais ce n’est pas automatique… C’est parce qu’on vit longtemps avec ses parents que ça crée un lien… Donc, pour faire lien, il faut d’abord le faire au niveau symbolique, au niveau imaginaire. Et là, c’est au réseau culturel et institutionnel de s’en charger.
Il faut aussi l’envie, non ?
L’envie de qui ? Vous pensez que la régionalisation belge était l’envie du peuple ? Non : c’était une logique économique et institutionnelle. L’élection directe du Bourgmestre, vous pensez que c’est une envie de la population ? Absolument pas : c’est une envie des politiciens d’entretenir un autre rapport avec la population, avec plus d’influence. La réorganisation des provinces, tout ça, ce ne sont pas des envies de la population. On présente une plate-forme d’identification à la population et puis ça marche, ou ça ne marche pas…
Justement : l’idée d’attirer les Flamands à Bruxelles, ça ne fonctionne pas vraiment…
Il y a une tradition qui identifie la ville à un mal nécessaire : sale, pleine d’étrangers, dangereuse, avec beaucoup trop de trafic… Cette image est entre autres véhiculée par les 330.000 naveteurs qui ne connaissent de la ville qu’un seul tracé, de la gare Centrale à la rue de la Loi, et qui retournent dans leur village en colportant cette image négative d’une ville avec laquelle ils n’entretiennent qu’un rapport d’usager. Leur idée, d’ailleurs fausse, est que la nature est plus paisible, qu’il y a moins de bruit (ce qui n’est pas vrai) et qu’ils mènent une vie moins compliquée qu’en ville. Ils considèrent que la vie en périphérie offre plus de confort, plus d’espace, et surtout plus d’espace privé (pour ceux qui savent se le payer). Mais moi qui habite près de Matongé, jour et nuit, si j’ai besoin d’un service, je marche et je l’ai. Dans un village, on ne trouve pas du pain à minuit, on ne trouve pas de nourriture pakistanaise… La ville du 19ème siècle, héritée de la ville médiévale, était une ville de commerçants et d’artisans, alors que la majorité de la population vivait dans les zones rurales. Avec la révolution industrielle, la ville est devenue le réservoir de cette nouvelle main d’œuvre, avec des quartiers ouvriers, en général insalubres, qui sont devenus le vivier du socialisme en Wallonie. En Flandre, quand l’industrialisation a continué, on a tout fait pour ne pas reproduire ces quartiers ouvriers. Les libéraux et le CVP ont répandu l’idée que les gens doivent vivre seuls, dans leur maison individuelle, sans infrastructures communautaires etc. Quand les socialistes étaient au pouvoir, il y a bien eu des mesures pour le logement social mais, quand c’était les autres, toute la politique du logement a été constituée de primes à la construction. Faites votre maison sur le terrain de la grand-mère et on vous aidera, d’abord par des primes, ensuite par le développement du transport travail-maison, pour permettre à chacun de rejoindre son village.
C’est donc la peur du rouge qui a orienté ce mode de développement ?
C’est clair que le CVP a voulu maintenir les gens sous contrôle moral du prêtre et que les libéraux voulaient défendre la propriété privée contre le collectivisme. Donc le grand débat sur le mode de vie, pas seulement le plus rationnel mais aussi le plus agréable, a été entaché par un message qui disait : le collectivisme est la dictature et l’individualisme est la liberté.
Cette peur serait-elle typiquement flamande ?
Il n’y a une spécificité flamande que dans la mesure où l’industrialisation s’y est faite plus tard. Le niveau de vie étant supérieur, on pouvait se l’offrir, tandis que les villes wallonnes, industrielles, ne pouvaient pas s’offrir de tels équipements. Mais toute la Belgique possède cette tradition anti-urbaine. L’idée d’Etat nation ou de Communauté donne aux gens l’impression d’être chez eux. Mais l’urbain, c’est l’opposé de ça car, en ville, il y a toujours « l’autre » ! Donc il vaut mieux ne pas se sentir tout à fait chez soi en ville… Ce qui explique peut-être que les Flamands bruxellois ont plus donné pour le caractère multiculurel de Bruxelles, par rapport à des francophones qui sont restés plus provincialistes.
Il existe, le fameux confluent entre Latins et Germains ?
Ce n’est pas mythique : à Bruxelles, ça se pratique tous les jours. Et ça pourrait encore davantage se faire. Par exemple, le caractère méditerranéen de Bruxelles, ce n’est pas les francophones mais les immigrés qui l’apportent : vivre dehors, dans la rue… Ce brassage se fait à Bruxelles mais c’est un phénomène essentiellement urbain. De là à ce que tous les Belges se retrouvent dans ce brassage, c’est une autre histoire… Mais ce n’est pas la « Belgitude », ou la « Belgique de papa » qu’il faut défendre, c’est le fait que la Belgique est un état multiculturel !
Sociologue et philosophe, Eric Corijn est professeur à la Vrije Universitij van Brussel (VUB). Il vit à Bruxelles.