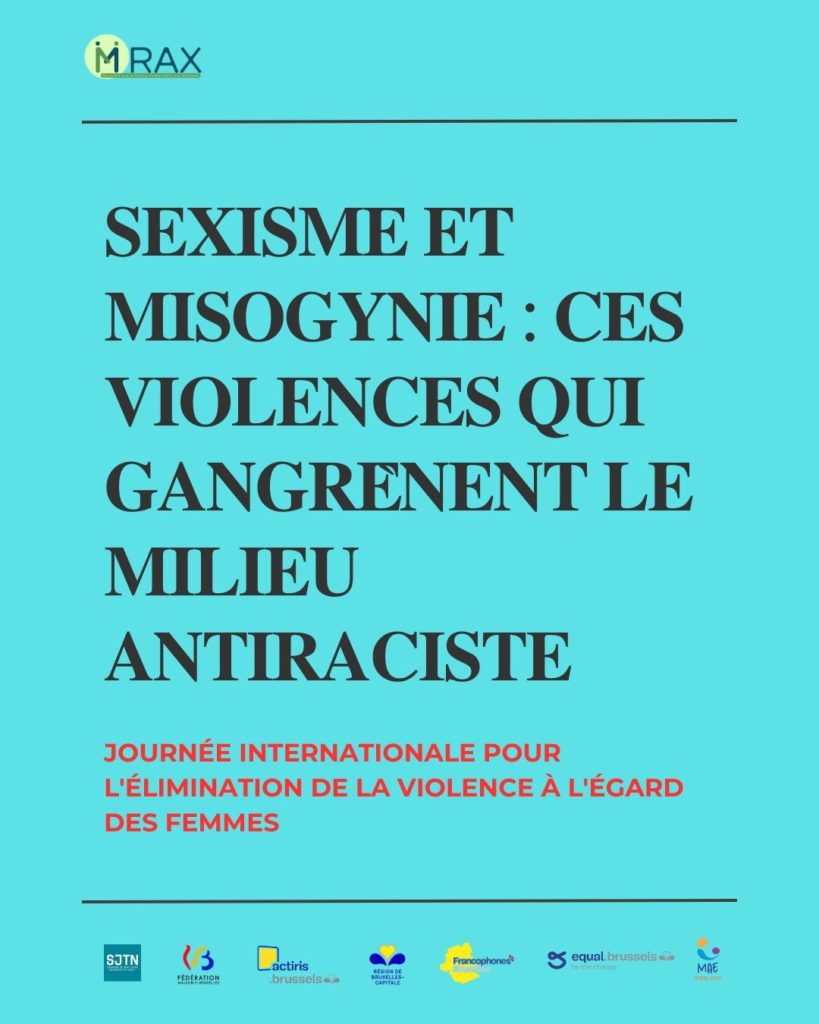http://www.lalibre.be/debats/opinions/mieux-connaitre-les-congolais-de-belgique-51b8bec1e4b0de6db9bc08e4
Gratia Pungu
En Belgique, le haut niveau d’éducation de la diaspora congolaise n’empêche pas un haut niveau de pauvreté et de précarité. Cette génération “suréduquée” assiste, impuissante, à un renversement de situation pour la seconde génération.
La diaspora congolaise est répartie largement des deux côtés de l’Atlantique. En Europe, son foyer principal n’est pas la Belgique comme on pourrait le croire a priori, mais bien la France (plus de 50 % de la population en immigration); l’ancienne métropole n’étant que le deuxième lieu d’établissement de la communauté mais surtout lieu de passage. La raison de cette désaffection tient en grande partie au fait qu’il est connu au sein de la diaspora que le taux de chômage des Congolais est bien plus élevé en Belgique qu’ailleurs; ce phénomène a d’ailleurs été mis en évidence par les études réalisées par Actiris et un nouveau constat en a été effectué par le Centre pour l’égalité des chances (1). La situation est paradoxale : loins du stéréotype colonial de l’Africain analphabète, les Congolais de Belgique forment la population la plus éduquée, celle qui compte de loin le plus d’universitaires, bien plus que les autres communautés immigrées ou que la population autochtone. Pourtant, ce haut niveau d’éducation n’empêche pas un haut niveau de pauvreté et de précarité. Dans le séjour avant tout, faute de conventions bilatérales à l’image de celles conclues avec les pays du sud de la Méditerranée, aucune immigration n’a jamais été envisagée pour les Congolais, et ce malgré une longue histoire commune. Dès lors, tout le parcours en Belgique est placé sous le signe du « momentané » et de la fragilité. Ce n’est pas sans conséquences sur la situation des familles où les femmes assurent souvent, par leurs boulots dans le domaine de l’aide aux personnes, l’essentiel des ressources régulières et partant, représentent la seule figure stable du foyer.
La discrimination s’exerçant, entre autres sur le marché de l’emploi, conduit les mêmes à souffrir du taux de chômage le plus élevé du pays. Si la réflexion sur la discrimination spécifique s’ébauche petit à petit en Belgique, la connaissance de la diaspora congolaise et des populations noires en général n’est nulle part. Or c’est bien d’une vraie diaspora qu’il s’agit (2). Elle combine, comme les diasporas historiques, juives et arméniennes qui nous sont mieux connues, les caractéristiques suivantes : l’exil, souvent violent, dans plusieurs pays différents, au gré des déplacements forcés à l’époque de l’esclavage, au gré des possibilités d’accueil dans le cadre des études et de l’asile, à l’époque contemporaine. Comme toutes les immigrations, la diaspora congolaise en particulier, africaine en général, a à cœur de garder un contact et d’œuvrer au développement de la région d’origine, que celle-ci soit « recréée », dans le cas des descendants d’esclaves, puisque leur origine n’est pas « traçable » ou réelle, s’agissant de l’immigration africaine post-indépendance. De là, l’élaboration d’une mémoire commune aux peuples noirs, une conscience partagée, dès avant les indépendances, et jusqu’à nos jours, en France et aux Etats-Unis d’abord, où s’élabore une réflexion en commun sur l’expérience partagée du racisme, de l’exploitation et de la discrimination, qui débouchera sur le mouvement panafricaniste dont Nkrumah, Senghor, Césaire, Dubois mais aussi Patrice Lumumba sont, pour des raisons diverses, des figures marquantes. Dans ce courant d’idées, le Congo et sa diaspora occupent une place majeure, par l’importance de ses cultures à l’échelle du continent : peu de Belges en sont conscients, mais le bassin du Congo est l’un des grands ateliers artistiques du continent noir; et si la Belgique est l’un des centres les plus connus en matière d’expertise et de commerce d’art africain, c’est au Congo qu’elle le doit. Par ailleurs, l’histoire tragique des colonisation et décolonisation du Congo et la mort violente de Lumumba ont alimenté la réflexion du mouvement panafricain; il suffit d’évoquer dans l’œuvre d’un Aimé Césaire la place particulière de l’ouvrage « Une saison au Congo ».
Le cas des Congolais de la diaspora installés en Belgique ouvre une nouvelle page à laquelle il convient d’être particulièrement attentif. Avant l’indépendance, les études universitaires leur étaient en pratique largement fermées par la volonté du colonisateur, contrairement à la situation française qui a encouragé et poussé une très peu nombreuse mais véritable élite intellectuelle. Après l’indépendance, c’est en nombre que les Congolais débarquent en Europe, accumulent les diplômes et créent une situation qui aurait dû modifier le stéréotype de « l’Africain illettré » en celui à tout prendre préférable, bien que toujours installé dans la dépendance, de « l’étudiant africain ». Fait nouveau dans l’histoire moderne des peuples d’ascendance africaine, depuis l’indépendance, c’est toute une génération qui a accès à l’éducation et au savoir, chose qui on s’en souvient était interdite aux esclaves du continent américain, extrêmement limité pour les colonisés. Tout imprégnée de principes méritocratiques, cette génération en espérait une amélioration substantielle de sa condition. La précarité de sa situation en immigration, la persistance des stéréotypes racistes dessinent une tout autre destinée : pour la première fois une génération « suréduquée » voit sous ses yeux se produire l’impensable : non seulement elle n’a tiré aucun bénéfice de ses efforts dans le pays d’accueil qu’est la Belgique, mais encore elle assiste impuissante au renversement de la situation pour la seconde génération. Cette dernière, largement déscolarisée parce que sans espoir, est sans admiration pour la génération des parents qui n’ont pas « réussi » malgré leur collection de diplômes.
Pour la première génération, un seul refuge dès lors : la religion. Celle-ci n’est donc pas uniquement la marque, comme on pourrait le penser, d’une forme d’arriération mentale. C’est plutôt un véritable remède à la souffrance vécue, en somme c’est bien « l’opium du peuple », un palliatif qui permet de supporter la souffrance.
Cinquante ans après l’indépendance, il est urgent de peser et de mesurer l’impact futur de cette situation en matière de cohésion sociale mais aussi d’image que l’on offre ainsi au monde.
(1) Voir notamment A. Martens, M. Van de Maele, S. Vertommen, H. Verhoeven, N. Ouali, Ph. Dryon, « Discriminations des personnes d’origine étrangère sur le marché du travail de la Région de Bruxelles-Capitale », KUL – ULB, 2010; Centre pour l’égalité des chances, « Belgique-Congo : 50 années de migration », Colloque du 1er juin 2010, pas encore d’actes malheureusement.
(2) A. Gueye, « Figures et expériences diasporiques », REMI, 2006.
(*) La revue de débats « Politique » n°65, juin 2010, consacre son dossier à « Le Congo dans nos têtes. Mémoire, stéréotypes et diaspora ». Avec, notamment, les contributions de Jean-François Bastin (La passion de Lumumba), Nathalie Delaleeuwe (Tervuren, un musée en mal de définition), Zana Etambala (Brève histoire de la diaspora congolaise), Antoine Tshitungu (Belgique, une mémoire coloniale sélective).