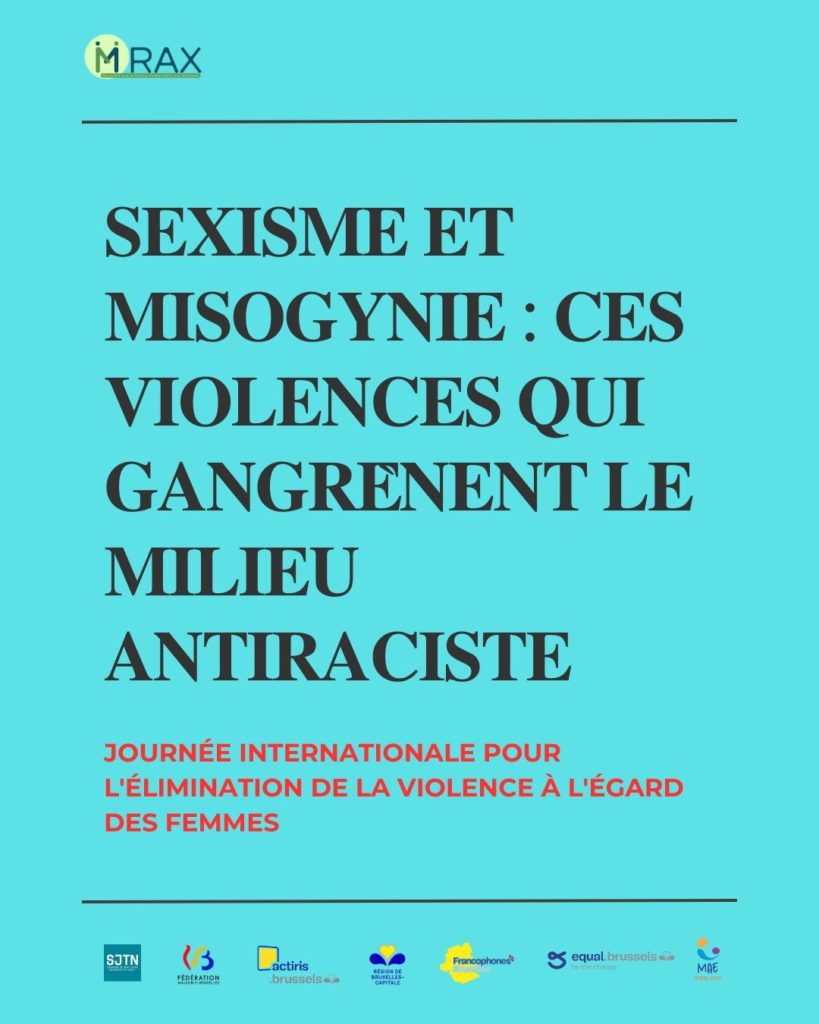Le départ du Tour de France de Bruxelles est l’occasion d’une réflexion sur certaines pratiques politiques voire d’une analogie audacieuse. Il ne sera pas question ici du cynisme apparent avec lequel les autorités de la Ville de Bruxelles gèrent la présence de réfugiés du parc Maximilien dans la foulée du départ du Tour, sur lequel il y aurait peut-être beaucoup de chose à écrire.
Revenons quelques années en arrières. Au début de ce siècle, Lance Amstrong règne sans partage sur le tour de France. Septuple vainqueur, il relègue ses éternels opposants Ivan Basso ou Jan Ulrich au rang de témoins de sa domination sans partage. Quelques années plus tard, le coureurs texans sera déclassé pour dopage et rayé du palmarès. Fait aussi intéressant qu’inhabituel, personne ne sera proclamé vainqueur de ces éditions du tour. En effet, les adversaires les plus directs d’Amstrong finirent chacun à leur tour par être suspendus pour dopage. L’histoire ne retiendra que la honte d’une époque où les principaux coureurs cyclistes participaient aux tour de France avaient, au détriment de l’éthique et des règlements sportifs, recours à des produits améliorant les performance. Ainsi, toutes les magnifiques performances qui suscitèrent les commentaires enthousiastes de nombre d’experts et de supporters étaient entachées par le dopage. Certaines voix comme celle de Christophe Bassons ou Fillipo Simeoni s’étaient pourtant élevées dans le peloton pour dénoncer cette réalité. Ces deux coureurs furent humainement ostracisés et sportivement défaits durant le reste de leur carrière.
Il est possible de faire un parallèle avec la réalité politique actuelle en Belgique et ailleurs. La xénophobie devient un moyen d’améliorer les performances de politiques, même parmi les plus médiocres. D’aucuns semblent considérer qu’expliquer son programme ou évoquer son bilan ne sont pas les meilleurs moyens de convaincre les électeurs. Il faut surtout attiser leurs peurs ou conforter leurs préjugés. La communication politique semble servir surtout à critiquer l’altérité nécessairement dérangeante voire menaçante. La popularité d’un Théo Francken avec ses saillies régulières dans les médias et dans les réseaux sociaux accrédite l’idée d’une partie du monde politique qu’il y a une manne électorale xénophobe dont il est possible de se saisir au détriment des valeurs démocratiques dont notre société se revendique. Ceux qui respectent le droit à la différence et ne veulent pas se faire élire grâce à leurs foucades sur les migrants, les musulmans ou les roms sont soumis à la concurrence déloyale de politiciens qui préfèrent s’adresser aux affects de l’électorat plutôt qu’à sa raison. Cela pose au moins deux questions. La première est d’ordre éthique. Les élus de la Nation se doivent de faire passer l’intérêt général avant leur calcul carriériste. Faire de la politique c’est représenter le peuple et non le segmenter entre la partie qui nous rapporte des voix et la partie sur laquelle on veut jeter l’opprobre. La seconde question est d’ordre juridique. La libération de la parole raciste constatée ces dernières années sera difficilement réversible si on ne sanctionne pas ceux qui l’ont rendue possible. Or, sachant que notamment pour les raisons évoquées plus haut, un certain nombre d’homme et de femmes politiques ont une lourde responsabilité, il est temps de réfléchir à la portée de l’immunité dont la plupart d’entre eux bénéficient en raison de leurs responsabilités. Cette disposition, historiquement justifiée pour permettre aux élus de travailler en toute sérénité, ne peut être un moyen de contourner la législation sanctionnant les appels à la haine, à la discrimination ou à la violence.
La xénophobie est devenue en politique une sorte de produit dopant presque aussi répandu dans le monde politique que l’EPO dans le peloton d’il y a vingt ans. Au détriment de l’éthique et des règles, elle améliore les performances de ceux qui l’instrumentalisent, pénalise ceux qui se refusent à y avoir recours et trompent ceux qui sont spectateurs. La seule différence, mais elle est fondamentale, est que dans le cas de la xénophobie, il y a des personnes qui ont à subir dans leurs chairs l’infraction à l’éthique et à la règle. La lutte contre cette pratique honteuse doit donc revêtir une priorité absolue dans une société démocratique. Il est temps de rayer du palmarès politique ces aventuriers sans scrupules.