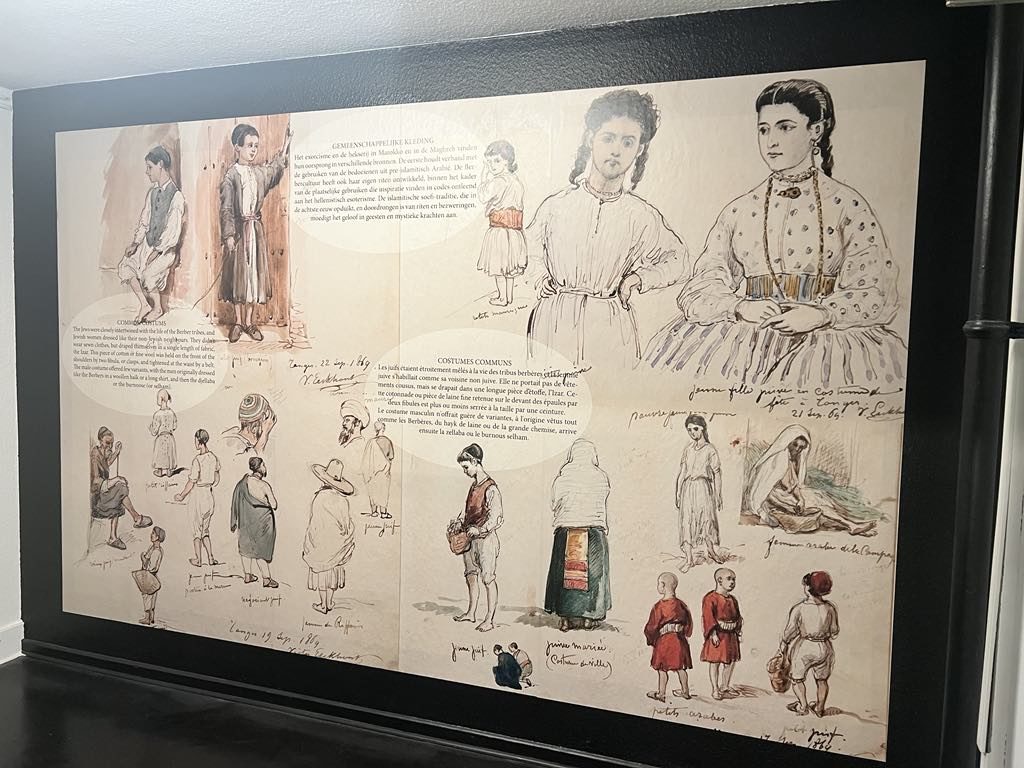C’est une nuit orange et chaude, une nuit de film américain. Nous sommes dans le Chicago du début des années 80.
C’est une nuit orange et chaude, une nuit de film américain. Nous sommes dans le Chicago du début des années 80.
Autour d’un lampadaire désampoulé, trois garnements s’échangent une Camel en simulant une conversation anodine où il y est question de filles, de figures de break-dance, et de filles encore. Dans l’habitacle d’une Ford Tonus, le quatrième larron, Saïd, s’active à desceller un autoradio. Un moteur dans le lointain. Il enfonce le tournevis sous l’appareil, ses mains sont moites et tremblent un peu, le coffrage cède quand soudain : sirènes, hurlements de freins, et cette lumière blanche qui lui glace les pupilles. Mains sur la tête, crie un flic. Bouge pas salopard, hurle un autre, en position de tir. Nous sommes à Chigago je le répète, et, à cause de cette connerie d’une fin de nuit adolescente, nul ne le sait encore mais la vie de ce gamin vient de basculer. A l’époque pourtant, il a tout juste dix-huit ans. L’âge de se faire passer un savon par ses parents, avant quoi, ceux-ci iront trouver le propriétaire du véhicule, plaideront l’inconscience et remboursont les dégâts causés par leur petit con de fils en lui assurant une bonne raclée. Pas mauvais bougre, le type acceptera de retirer sa plainte. Moi aussi, j’en ai faites des conneries à son âge, leur confie-t-il même, avec un petit sourire de nostalgie. Seulement, au poste de police on répond sèchement : trop tard. Et la machine est lancée.
Vol qualifié, répète le juge, vol qualifié. Malgré l’absence d’antécédent, le jeune Saïd se ramasse sept mois fermes. Sept mois de prison pour un autoradio. Hébétée, la famille accepte la sentence en se disant que décidement…
Pompages, promenade, pompages, sept mois passent. Sept mois, ce n’est pas le bout du monde, mais c’est quand même un peu long, aussi quand on lui présente un arrêté d’expulsion synonyme de liberté, Saïd signe le cœur léger. Ce qu’il ignore : dans ce pays-là et dans ces années-là, tout étranger condamné à une peine qui dépasse les six mois peut être banni du territoire…
Ce qu’il est donc. Banni. Expulsé. Dehors.
Et voilà Saïd perdu dans un Maroc dont il ne parle pas trente mots de la langue. Quelques semaines d’errance plus tard, on le retrouve à Chicago. Clandestin dans sa propre ville. Même pas vingt ans. Désormais il s’appelle Mohamed, comme son frère, sur la carte d’identité duquel il a plaqué sa photo. Petits arrangements avec les vivants. Désormais il y a deux Mohamed du même nom dans le quartier. L’un, Mohamed n°1, étudiant la comptabilité, l’autre, Mohamed n°2, Mohamed-Saïd donc, qui travaille dans un garage. Le premier qui devient un caïd du ping-pong, le second qui a la mauvaise idée de se transformer en espoir de l’athlétisme local. C’est qu’il court vite, Mohamed-Bis, si vite que bientôt il gagne presque le semi-marathon de la ville, juste derrière les Ethiopiens. On lui suggère la naturalisation, des bons coureurs de fond comme lui, ce pays-là n’en compte pas tant.
Et puis là, forcément, patatras…
Faux et usage de faux, répète le juge, faux et usage de faux. Et vlan, dans un grand coup de maillet il lui flanque dix-huit nouveaux mois de prison.
Dix-huit mois pour avoir substitué une photo sur un bout de carton vert, dans le seul but de continuer sa vie dans le pays qui vous a vu naître, jouer, grandir, c’est beaucoup pour le moral d’un jeune homme.
En prison, Mohamed-Saïd découvre la came…
A sa sortie cette fois il ne court plus. Sa démarche a changé, son visage s’est creusé, il n’a toujours pas le droit au séjour. Ni de travailler. Ni de se faire soigner. Quand on le contrôle, et avec la tête qu’il a désormais, on le contrôle souvent : quelques mois d’emprisonnement puis on le relâche, son ordre de quitter le territoire en poche. D’une détention administrative à l’autre, de petits délits en petits délits, il finit par braquer un drugstore. Se fait désarmer. Se reprend trois ans. Presque avec soulagement.
Depuis sa dernière sortie, dix-sept ans après l’épisode de l’autoradio, celui que même l’administration continue à appeler Mohamed n’est plus qu’une ombre dans la vie des siens. Dix ans que sa soeur s’étrangle à sa place dans les couloirs des administrations. Dix ans qu’elle écrit à gauche et à droite pour faire simplement accorder à son frère le droit d’exister, tenter de sauver ce qui peut l’être encore, plus grand chose peut-être.
Dans ce pays-là, on engage des sophrologues pour des employés de bureau que l’incertitude professionnelle rend fou. Dans ce pays-là, le coût social du stress commence à produire de bien terrifiants débats sur les plateaux télévisisés. Et dans ce même pays, une loi moyenâgeuse permet de confisquer l’identité de quelqu’un pour une broutille que l’auteur de ces lignes aurait très bien pu commettre aussi, ben oui, la jeunesse est turbulente madame, et qui, à lui, parions-le, n’aurait pas valu quatre heures de sermon, parce qu’il n’est pas né à Chicago, lui.
Elle est belle la société américaine pensez-vous. Mais le Chicago dont il est question, c’est ce quartier de Bruxelles coincé entre le canal de Willebroek et le boulevard Jacqmain. Et cette histoire est une histoire vraie, une parmi tant d’autres, conséquence d’une loi dégueulasse dont personne ou presque ne mesure l’impact : la double peine. Ou bannissement. C’est-à-dire, en français, la perpétuité, madame.