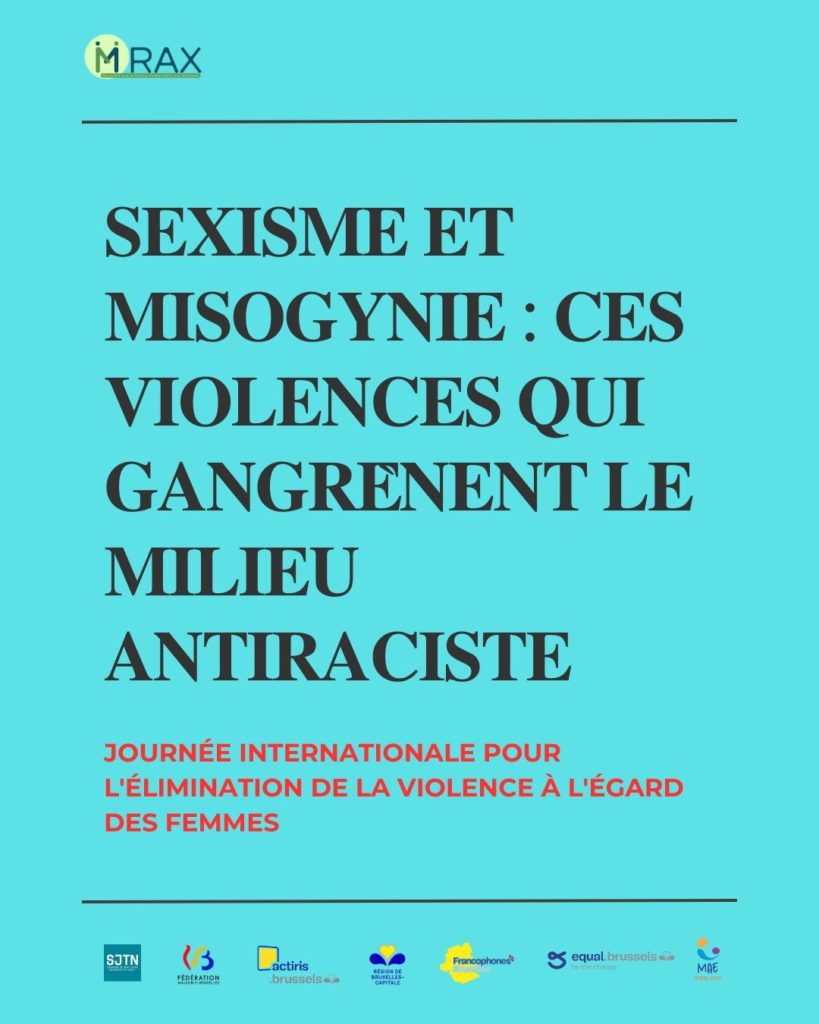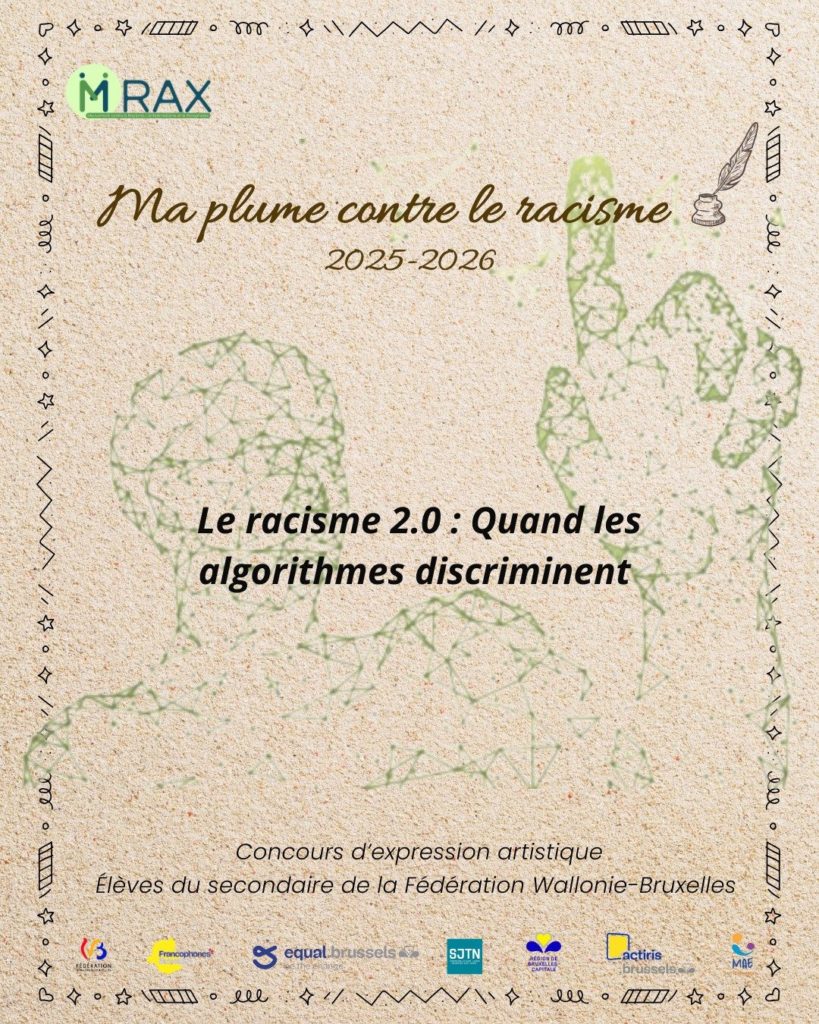Le combat contre le racisme est, en principe, un combat noble. Un combat qui se veut le reflet d’une humanité en quête de justice, d’égalité, de reconnaissance et de réparation. Il devrait être un rempart contre toute forme d’oppression. Un refuge pour celles et ceux que le système marginalise, exclut ou efface. Mais trop souvent, derrière les slogans engagés et les appels à la solidarité, se cachent des logiques de domination tout aussi destructrices. Des violences qui ne disent pas leur nom, mais qui brisent des vies, fragilisent les voix, et épuisent celles et ceux qui en sont les cibles.
Ce que je veux dire ici, je le dis à visage découvert, sans détour, avec la force du vécu et l’espoir du changement. Nous ne pouvons plus détourner les yeux. Nous ne pouvons plus taire ce qui ronge nos espaces de lutte de l’intérieur. Le sexisme et la misogynie sont bien présents dans nos milieux militants, y compris dans les organisations les plus engagées.
Il ne s’agit pas de cas isolés ou d’erreurs individuelles. Il s’agit de systèmes de pouvoir reproduits au sein même des structures censées les combattre. Des structures qui brandissent le mot « justice » à l’extérieur, mais qui, à l’intérieur, peuvent étouffer, infantiliser, mépriser ou agresser celles qui ne rentrent pas dans les normes du pouvoir masculin.
La misogynie dans le milieu antiraciste n’a rien d’un accident de parcours. Elle n’est ni marginale, ni exceptionnelle. Elle est là, tapie dans les replis du quotidien militant, tolérée à demi-mot, minimisée d’un haussement d’épaules, ou simplement ignorée comme si elle n’était qu’un détail.
Parfois, on lui met un masque plus acceptable : on parle de désaccord idéologique, de conflit de personnalité, ou de divergences stratégiques. On l’enrobe de mots savants, on la dissout dans des explications rationnelles. C’est plus commode. Plus supportable.
À force de les nier ou de les banaliser, on abîme des femmes, on fragilise des parcours, on étouffe des voix. On détruit, sans bruit, ce qu’on prétend défendre haut et fort : la dignité, la justice, l’égalité.
Mais il faut oser le dire : ces tensions, ces silences, ces mises à l’écart… ce sont des violences. Des violences réelles. Subtiles, certes, mais profondément destructrices. Elles blessent. Elles fatiguent. Elles isolent. Et surtout, elles ont un coût. Un coût humain. Un coût militant. Un coût collectif.
Un coût humain, d’abord. Car derrière chaque femme réduite au silence, chaque militante poussée vers la sortie, chaque dirigeante attaquée, il y a des engagements brisés, des énergies sacrifiées, des combats étouffés.
Un coût politique, ensuite. Car un mouvement qui nie les oppressions en son sein perd en cohérence, en crédibilité et en puissance.
Et enfin, un coût collectif. Car nous avons besoin de toutes les voix, de toutes les intelligences, de toutes les forces pour lutter contre les injustices. Lorsqu’on attaque les femmes, on affaiblit l’ensemble du combat.
Il est temps de dire les choses telles qu’elles sont. On ne peut pas se dire antiraciste si l’on ferme les yeux sur le sexisme.
On ne peut pas prôner l’égalité tout en perpétuant la hiérarchie des genres.
Et surtout : on ne peut pas prétendre changer le monde si l’on continue à reproduire, dans nos propres cercles, ce que nous dénonçons à l’extérieur.
FEMMES DANS LA LUTTE : DOUBLE PEINE, SILENCE IMPOSÉ
Être une femme engagée, c’est souvent devoir marcher sur un fil. Naviguer entre fermeté et douceur, entre compétence et modestie, entre visibilité et prudence. Être une femme noire engagée, c’est parfois devoir marcher seule, dans des couloirs où personne ne vous attend, où votre présence dérange avant même que vous ayez pris la parole.
Dans les milieux militants, censés être les bastions de la justice et de l’inclusion, les femmes – toutes origines confondues – se heurtent à des murs invisibles mais puissants. On leur coupe la parole, on les écoute à moitié, on les qualifie d’ »émotionnelles », d’ »instables », de « trop radicales », de « pas assez stratégiques ». Comme si elles portaient la faute d’avoir osé dire tout haut ce que d’autres se contentent de murmurer en privé.
Leur expertise est minimisée, leur parole est suspecte, et leur simple présence devient un enjeu. Trop souvent, elles doivent en faire deux fois plus pour être considérées à moitié. Leur colère est pathologisée, leur assertivité est perçue comme une menace, et leur silence, lorsqu’il arrive, est interprété comme une faiblesse. On les accuse de diviser alors qu’elles tentent simplement de nommer ce que tout le monde voit, mais que peu osent affronter.
Pour celles qui sont visées plus directement – dirigeantes, porte-paroles, femmes visibles dans la sphère publique ou médiatique – les attaques se font plus violentes encore. Des campagnes de discrédit insidieuses sont orchestrées dans l’ombre. Des rumeurs sont lancées, des propos déformés, des alliances brisées. On les isole, on les fait douter, on essaie de les épuiser moralement pour les faire taire. Ce ne sont pas des maladresses. Ce ne sont pas des incompréhensions. Ce sont des stratégies. Des stratégies de pouvoir. Des tactiques de domination.
On ne les frappe pas toujours physiquement, mais on les éteint à petit feu. On les pousse à s’auto-censurer. À quitter les espaces. À s’effacer. On leur fait payer le prix d’avoir osé prendre la parole, d’avoir eu une vision, d’avoir voulu mener.
Je le dis en connaissance de cause. Certaines d’entre nous l’avons vécu et/ou le vivons. Ces coups bas ne sont pas l’exception. Ils sont systémiques, normalisés, parfois même défendus par des milieux qui se disent progressistes. Et ils ne touchent pas seulement les femmes en position de pouvoir : ils frappent aussi les jeunes militantes, les bénévoles, les stagiaires, les femmes migrantes ou racisées qui entrent dans ces sphères avec foi et dignité, et qui ressortent blessées, éteintes, parfois brisées.
Cette violence, cette double peine, ne peut plus être ignorée. Car tant que les femmes seront attaquées pour ce qu’elles sont – et non débattues pour ce qu’elles proposent – aucun projet émancipateur ne pourra aboutir.
OSONS DENONCER !
On ne nous dit pas frontalement de nous taire. On préfère d’autres chemins : semer le doute, nous isoler, nous épuiser. On nous accuse de trop en faire, de « nous victimiser », de ne pas être assez diplomates. On nous rappelle à l’ordre au nom du collectif, mais ce collectif-là ne semble avoir de valeur que lorsqu’il nous efface doucement de la scène.
Cette violence ne fait pas de bruit, mais elle fait des ravages. Elle freine nos élans, nous pousse à l’autocensure, nous oblige à nous défendre sans relâche. Elle transforme nos luttes en labyrinthes, nos voix en murmures, et nos ambitions en batailles épuisantes.
Il est temps de la nommer. De dire qu’elle existe. Qu’elle est réelle. Et qu’elle ne passera plus sous silence.
Nous, femmes engagées dans les luttes antiracistes, connaissons cette réalité de l’intérieur. Pas dans les couloirs de l’extrême droite, non. Mais dans les espaces mêmes où nous luttons pour la justice, l’égalité et la dignité humaine.
C’est là, dans ces sphères censées être des refuges, que certains hommes racisés, supposément alliés, deviennent des opposants discrets, mais acharnés. Ils ne haussent pas le ton. Ils murmurent. Ils insinuent. Ils construisent patiemment des murs autour de nous.
Rumeurs, harcèlement moral, tentatives de discrédit public… Ce ne sont pas des maladresses. Ce sont des stratégies. Des coups bas qui visent non seulement nos personnes, mais aussi ce que nous représentons : la possibilité pour une femme noire d’occuper un poste de pouvoir, de parler fort et juste, d’agir avec détermination.
Ces attaques cherchent à nous faire vaciller, à nous faire douter, à nous faire taire. Elles sapent notre légitimité, ébranlent notre autorité, perturbent notre paix. Surtout lorsqu’on dirige, lorsqu’on incarne une voix.
Mais nous ne plierons pas.
Parce que nous savons que nos luttes sont justes.
Parce que nous savons que notre présence dérange, précisément parce qu’elle est nécessaire.
Et parce qu’au milieu du bruit et du silence, nous avons encore, et toujours, cette parole à faire entendre.
Me faisant le porte-voix de ces femmes, j’en appelle, du fond de ce que tant de femmes et de femmes racisées vivent et portent en silence, à toutes les structures, collectifs, associations et réseaux qui se revendiquent de l’antiracisme.
Il est temps. Temps de se regarder droit dans les yeux. D’oser voir ce qui se joue, non pas dans les discours, mais dans les pratiques. Il est temps d’abandonner les faux-semblants, de faire tomber les masques de bonne conscience. Car ce que nous laissons faire entre nos murs en dit souvent bien plus que ce que nous dénonçons à l’extérieur.
Un mouvement antiraciste qui blesse ses militantes, qui les use, les réduit au silence, ou les abandonne aux attaques, n’est pas un mouvement en lutte. C’est un mouvement qui trahit. Qui oublie que l’on ne combat pas l’injustice en reproduisant d’autres violences. Qui oublie que ce que l’on sacrifie aujourd’hui sur l’autel du pouvoir, c’est notre propre avenir.
La dignité des femmes noires, des femmes racisées et des femmes en général, ne peut pas être la variable d’ajustement de stratégies collectives. On ne peut pas leur demander force, loyauté, intelligence, bravoure… tout en détournant le regard lorsqu’elles sont piétinées.
On ne construit pas la liberté en effaçant celles qui la réclament depuis toujours.
On ne bâtit pas l’égalité sur des silences complices.
Et l’on ne fera jamais naître un monde plus juste si l’on continue de briser celles qui, déjà, en tiennent les fondations à bout de bras.
Ce combat ne peut ni avancer, ni tenir sans les femmes. Sans leur souffle, leur lucidité, leur inlassable présence.
Alors aujourd’hui, que chacun, que chacune, prenne sa part. Il ne s’agit pas de leur « faire une place » : elles sont là. Elles ont toujours été là.
Il s’agit, enfin, de les reconnaître. De les écouter vraiment. De les respecter sans condition. De les protéger sans hésitation.
C’est à cette seule condition que l’antiracisme pourra redevenir ce qu’il promet d’être : un levier d’émancipation véritable, un lieu d’humanité debout, un refus clair et entier de toute oppression — quelle qu’elle soit, et contre qui qu’elle se retourne.
Francine Esther KOUABLAN
J’ose dénoncer !